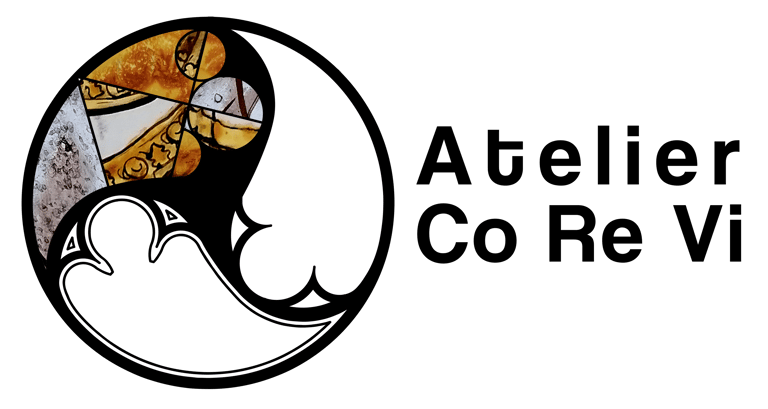Le vitrail
En contexte architectural, la cloison de verre en vitrail est un objet composite par essence, qui est intégrée et soutenue dans l’architecture par des serrureries en fer forgé ou par des menuiseries. Une verrière est composée de plusieurs unités manipulables : les panneaux de vitraux font en moyenne entre 1 m² et 2 m².
À la fin de l'époque médiévale, le procédé de fabrication des vitraux fait appel à plusieurs verriers de spécialité différente :
Le souffleur de verre qui produit de grandes feuilles, circulaires (produit de la technique du soufflage en cive) ou rectangulaires (produit de la technique du soufflage en manchon) de verre coloré dans la masse à l’aide d’oxydes métalliques.
Le verrier-vitrailliste qui choisit les couleurs de verre, les coupe et les sertis dans les baguettes profilées en plomb.
Le peintre-verrier qui dessine la maquette à échelle réduite et le carton à échelle 1, peint et cuit les pièces de verre, et également peut tirer parti de procédés de gravure du verre (mécanique et chimique).
À l'époque contemporaine, l'offre de verre est diversifiée par l'utilisation de procédés industriels (étirage, laminage, float, etc.).
Des techniques alternatives de sertissage ont été mises au point : le sertissage Tiffany par exemple, permet de créer des assemblages en trois dimensions comme des abats-jour.
La maîtrise des cuissons à haute température permettent par ailleurs de créer des décors en fusionnant des pièces de verre entre elles avec la technique de la fritte de verre et du fusing.
« Le vitrail est un ensemble de pièces de verre, généralement peu épaisses (de 2 à 4 mm), découpées en formes diverses selon un dessin préétabli, translucides ou transparentes, colorées ou non et maintenues entre elles par un réseau de plombs. Les pièces de verre peuvent recevoir un décor de grisaille, jaune d'argent, émaux ou gravure. Le mot vitrail désigne donc une technique et non un objet.
N.B. Bien que ce terme soit souvent utilisé comme synonyme de verrière, ne l’employer que dans le sens technique défini ici. »
Isabelle Pallot-Frossard et al.
Manuel de conservation, restauration et création de vitraux, Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, 2006. P. 113
L’art du vitrail est millénaire. Des définitions des techniques artistiques pour la production des vitraux peuvent être consultées dans les ouvrages tels que le Vocabulaire typologique et technique ou encore le Manuel de conservation, restauration et création de vitraux édité par le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques.
Définition
L'éventail de techniques proposées par l'atelier :
Traditionnel avec des profilés de plomb, et une brasure étain/plomb à chaque intersection.
Tiffany avec des rubans de cuivre adhésifs posés sur les chants des pièces et une brasure étain/plomb pour assembler les pièces entre elles.
Le sertissage :
La gravure :
Gravure mécanique au sablage à air comprimé
La peinture sur verre :
Les peintures sur verre sont pour la plupart des peintures vitrifiées, cuites à plus de 500 °C. Le verre étant un piètre conducteur de chaleur, il est nécessaire de respecter des courbes de cuisson précises. La montée en température doit être très progressive, tout comme la descente en température afin de relaxer les tensions internes du verre, qui peuvent autrement conduire aux casses de feu.
Grisailles. Cette peinture vitrifiée opaque est composée d’un mélange d’oxydes métalliques ainsi que d’un verre riche en silicate de plomb, le fondant, qui permet d’abaisser la température de cuisson. La couleur des grisailles dépend du type et de la concentration d’oxyde présents. Présentée sous forme de poudre, elle est mélangée à un véhicule, additionné ou non de liant. Les techniques de décorations à la grisaille sont essentiellement les traits de contour, les lavis, les modelés et les enlevages pour sculpter la lumière. Après application et séchage, la grisaille est cuite entre 620 °C et 640 °C.
Jaune d'argent. Le jaune d’argent est une technique de décor à chaud qui produit une teinture du verre en surface ; le décor obtenu n’a pas d’épaisseur. Les jaunes d'argent utilisés par l'atelier sont produits à base de sels d'argent (sulfure, chlorure) et d'ocre. La couleur de la teinture produite est jaune à ambre, parfois avec des reflets bleu métallique. Certains verres sont plus réactifs que d’autres, car son action de teinture dépend en partie de la composition chimique du verre.
Sanguine. La sanguine est une peinture rouge à base d’oxydes de fer (hématites ou goethite) qui sert à colorer les représentations de carnations (rouge des pommettes, nez, lèvres, paupières, etc.) ou pour rendre certains matériaux (par exemple le bois). À l'époque contemporaine, les recettes de sanguine incluent une part importante de fondant, rendant le comportement de cette peinture assez proche de celui d’une grisaille.
Émaux. L'émail est une peinture constituée d’un verre très fusible, coloré dans la masse par des oxydes métalliques et broyé très finement pour être mis en œuvre à l’aide d’un véhicule. À la cuisson, la couche d’émail fusionne et devient à l’œil nu une couche unie, translucide et brillante en surface. Les émaux sont déclinés en plusieurs couleurs.
Conservation-restauration de vitraux
© Atelier Co Re Vi - 2025
Tous droits réservés.